8.16 Aux origines de l'anthropologie
(Fiche pédagogique n° 17)
(cette fiche comprend trois parties)
(Suite...)
« L'arbre de la liberté serait-il le seul qui ne pût être acclimaté au Jardin des Plantes ? »
Fils de jardinier, André Thouin, aujourd'hui quasiment inconnu (ses archives, déposées au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, ont été révélées et partiellement publiées par Yvonne Letouzey : Le Jardin des Plantes à la croisée des chemins avec André Thouin (1747-1824), Éditions du Muséum, 1989 ; les numéros de pages sans autre référence renvoient à cet ouvrage), a été le correspondant des encyclopédistes et des voyageurs de son temps. Sa notice nécrologique, écrite par Geoffroy Saint-Hilaire (citée dans Letouzey, p. 670), rapporte que « M. Thouin n'a pas eu la douceur d'apprendre avant sa mort, que le 23 septembre dernier, ses services comme propagateur des végétaux utiles et comme bienfaiteur de l'humanité, avaient été l'objet d'un hommage public à New-York. De semblables honneurs et au même titre, lui avaient aussi été plus anciennement décernés en Angleterre ». Reconnu de son vivant comme le principal concepteur, pourvoyeur et animateur du premier jardin botanique d'Europe, membre de nombreuses sociétés scientifiques, de Londres à Philadelphie, alors qu'on célèbre aujourd'hui le « plus grand herbier du monde » (ouverture au public en novembre 2013 d'une exposition permanente de l'herbier du Muséum rénové), sait-on le rôle d'André Thouin dans cette collecte ? Oublié de la galerie de portraits de l'ouvrage paru à cette occasion (L'Herbier du Muséum, Cécile Aupic, Denis Lamy et Odile Poncy, Paris : Artlys/Muséum national d'histoire naturelle, 2013 ; l'herbier du Museum : près de « huit millions d'échantillons collectés depuis plus de 450 ans » - préface, p. 5) – il est vrai que son herbier personnel, acquis par le botaniste Jacques Cambassedes (1799-1863), se trouve aujourd'hui à l'université de Montpellier et non au Muséum – il fait partie des acteurs anonymes de cette « république des savants » qui ont œuvré au déchiffrement du monde. Le rôle des naturalistes dans la fondation des sciences humaines tient à ce qu'ils impriment à l'enquête la forma mentis requise, en l'espèce, pour une recension positive des formes culturelles – quand ils ne sont pas eux-mêmes les collecteurs de ces échantillons d'humanité – préalable à la pétition de l'équivalence des valeurs. A travers André Thouin, c'est le désir d'universalité de la modernité qui s'exprime.
Quand son père décède soudainement, en 1764, André Thouin est nommé, sur la proposition de Buffon et de Bernard de Jussieu, qui ont guidé sa formation scientifique, Jardinier en chef du Jardin du Roi. Il a dix-sept ans et demi. Au début des années 1770, il commence à expérimenter, à la faveur d'un réseau de correspondants quasi planétaire, l'acclimatation de graines venues du monde entier. Dans son Utopia's Garden, French Natural History from Old Regime to Revolution, E. C. Spary donne, pour les années 1760 à 1791, à partir des archives du Muséum, une représentation en cartes (France, Europe, Monde) de ce réseau (Spary, The university of Chicago Press, Chicago and London, 2000, p. 70-75). Thouin écrit à Linné, qu'il nomme « le Dictateur de la Botanique » (i. e. celui qui dicte), lui présentant, dans son premier contact « 80 espèces de graines dont, précise-t-il, les plantes me sont inconnues dans vos ouvrages, soit que la plupart étant nouvellement arrivées dans ce pays, elles n'aient pas encore passé sous vos yeux, soit que mon peu de lumière me les fasse méconnaître ou qu'étant trop difficile, je ne veuille pas nommer au hasard des êtres qui, peut-être n'ont pas encore été nommées par vous, Monsieur… » (p. 52-53). « Le dix années qui précèdent la mort de Buffon en 1788, écrit Letouzey, marquent l'apogée de Thouin comme 'Jardinier-Botaniste, Instructeur et Dispensateur de plantes nouvelles' […] Il devient, dans sa partie, un homme célèbre à la tête du Jardin Botanique le plus riche du monde. Il forme des jardiniers que s'arrachent les cours d'Europe et d'ailleurs ; il instruit les 'récolteurs' qui acompagnent les grandes Expéditions à la découverte du monde. Il se procure les végétaux qui manquent au Jardin par des échanges, et ceci au moyen d'une correspondance colossale » (p. 63).
Thouin est responsable de la restauration et du doublement du Jardin du Roy dont « M. de Buffon s'occupait un peu en l'occupant beaucoup » (p. 63). A propos d'un conflit de propriété lié à l'extension du Jardin, une lettre au ministre Necker défend l'intérêt du Jardin pour « l'instruction publique » : « Il est le rendez-vous des savants, des étrangers, et de la classe la plus honnête des citoyens par l'agrément de sa position, la salubrité de l'air qui y règne, l'agrément de ses promenades. Pendant les cours, surtout celui de Botanique, il y a régulièrement 1 000 à 1 200 étudiants, la plupart étrangers dans l'École des plantes qui a coûté des sommes considérables à l'État pour l'amener au point de perfection ou elle est » (p. 68). En 1775, Thouin établit le catalogue des graines qu'il a reçues avec leur lieu d'origine et l'état de leur culture au Jardin. Cette « liste numérotée d'espèces et de genres groupés par familles » comporte 3 677 entrées (p. 98). Parmi ces espèces, le « Lit-chi », Euphorbia Litchi, arbre qui passe pour donner un des meilleurs fruits. On pourra l'acclimater en Provence » (p. 99). Les graines que reçoit Thouin transitent souvent par la voie diplomatique. Il entretient ainsi des relations suivies avec le ministère de la marine et le Secrétariat pour la correspondance aux Affaires étrangères. Ses relations et son crédit personnel lui permettent d'intervenir en faveur de Dombey, assigné à résidence à Cadix (supra). Mais il reçoit aussi, par des voyageurs étrangers qui lui ont rendu visite des lots de graines qu'il met en culture – ou de visiteurs qui lui confient des envois dont ils ont été destinataires, tel Jean-Jacques Rousseau à qui Catherine II a adressé 75 « espèces de Sibérie » (p. 117).
La diversité et la qualité des visiteurs de Thouin étonnent d'un simple « jardinier ». L'homme politique et futur Directeur La Révellière-Lépeaux – lui-même botaniste – dresse un tableau de ces réunions au domicile de Thouin et souligne « le contraste de ces conversations [roulant tant sur des « questions de l'ordre le plus élevé » que sur d'« aimables » anecdotes] avec la modeste cuisine dans laquelle elles se tenaient […] C'est dans cette même cuisine où la famille avait reçu souvent J.-J. Rousseau, que le vénérable Malesherbes, garde des sceaux, débarrassé de sa simarre, venait converser, assis sur une huche, pendant des heures entières, avec M. Thouin et Mme Guillebert, pour lesquels il avait une estime et une affection toute particulières ». Après 1778, Malesherbes devient un familier de la maison. Il a cinquante-sept ans, Thouin en a trente (p. 126). Turgot, Lavoisier, Condorcet, Houdon… compteront parmi les relations de Thouin.
Le fils de Linné (qui ne possède « ni l'érudition ni la capacité de travail de son père ») fait appel à Thouin : il « craint que la disette des plantes ne se fasse sentir » dans son Jardin Botanique. Linné arrive à Paris. Thouin lui confie « 1 500 plantes sèches qu'il a choisies dans [ses] herbiers ». Linné décède à son retour en Suède et Thouin, apprenant que l'épouse de Linné père va vendre ses collections (« On nous assure que la collection de ce savant va être vendue à l'étranger ») cherche à récupérer ou à préserver ses précieuses plantes. Il explique dans sa lettre au directeur du Jardin Botanique d'Upsal (à qui il avait préalablement fait plusieurs envois de plantes) : c'est à l'avancement et à la gloire de la Science que je faisais le sacrifice de ce que j'avais de plus précieux […] un prêt qui devait tourner à l'avantage des Sciences… ». Faisant état de la provenance lointaine de ces plantes, il plaide : elles constituaient « non seulement mes plus beaux échantillons des plantes que j'avais en double, mais même je me suis défait en sa faveur de plusieurs choses que j'avais uniques ». « La plupart m'avaient été communiquées par nos voyageurs français les plus modernes tels que MM. Commerson, Botaniste du Roy qui fit le tour du monde avec M. de Bougainville, M. Sonnerat, commissaire de la marine à Pondichéry, M. Thiery, Pensionné du Roy à St-Domingue pour la culture de la cochenille, M. Dombey, Botaniste du Roy au Pérou et de plusieurs autres personnes moins connues […] » (p. 137-138).
Thouin se trouve ainsi au terme d'une entreprise d'exploration scientifique collective, le gardien, le conservateur et le propagateur des plantes nouvelles… Il en est aussi la cheville ouvrière. C'est lui qui forme les « collecteurs » et les jardiniers qui sont nécessaires à cette récolte… En 1788, le Secrétaire d'État à la marine, le comte de La Luzerne (qui a été gouverneur des Isles sous le vent de 1785 à 1787) écrit à Thouin : « Je voudrais bien conférer avec vous et sur les moyens de vous procurer des graines des différents pays de l'univers, et sur ceux d'établir à cet égard une communication réciproque entre nos colonies » (p. 174). Thouin répond au ministre par un programme en neuf points où il expose le mode opératoire et la logistique nécessaire à l'accomplissement de ce projet. Il conclut son mémoire en mettant en avant les moyens dont dispose du Jardin du Roy « au local plus que doublé ainsi que les fonds destinés à sa culture […] meublé de nouvelles serres […] à la correspondance étendue » (soit les résultats les plus évidents de son œuvre à la tête du Jardin), tout cela stimulé par « l'arrivée dans le Ministère de la Marine d'un Ministre qui connaît tout le prix des progrès de l'Agriculture, son influence sur le bonheur de l'humanité, qui les protège et les accélère par des vastes connaissances. » Il liste les « questions à faire à l'administration de chaque colonie française des deux Indes ». Après avoir recensé le productions d'Europe existant dans le Jardin du Roy à l'Isle de France, il dresse « l'état des végétaux qui se trouvent en France et qui manquent à nos colonies des Isles de France et de Bourbon » (p. 177). Il propose d'y introduire (entre autres) l' Azerolier d'Italie, le Caroubier, le Cerisier, le Cognassier du Portugal, le Figuier, l'Arbre à cire, la Pomme de terre, la Menthe poivrée d'Angleterre, le Raifort sauvage (anti-scorbutique)… Alors qu'un départ est prévu pour Le Cap, l'Isle de France, Bourbon et Pondichéry, Thouin souhaite « profiter de ce voyage pour faire venir les productions de ces différents pays, et demande qu'on place un jardinier sur ce vaisseau pour soigner les plantes vivantes qu'on peut rapporter » (p. 179). Il évalue le coût de cette expédition « agricolo-botanique » dans laquelle il y a deux chances à courir : « celle de l'exportation et celle de l'importation » (p. 179). Il rédige un mémoire contenant les « Instructions pour le Sieur Joseph Martin relativement à son voyage à l'Isle de France et à la conservation des plantes qu'il transporte d'Europe et à celles qu'il doit y rapporter » (p. 184). Une lettre de Thouin permet d'apprendre que « M. le Comte de Buffon n'est pas dans la confidence de la plus importante partie du projet qui a pour but d'enrichir nos colonies tandis qu'il n'a en vue que d'augmenter notre collection [et qu'il ne peut] passer dans [ses] comptes que les dépenses relatives au service direct du Jardin du Roy » (p. 182). Le jardinier-voyageur (il signe « Martin Voyageur ») est de retour au Havre en juillet 1789, sa mission accomplie. Il remet à Thouin « un envoi d'arbres et de plantes en nature ramassés aux Isles de France, de Madagascar, Cayenne, St-Domingue, la Martinique et au Cap de Bonne Espérance, et le contenu dans 136 tonneaux. Il était composé de plus de 1 200 individus parmi lesquels se sont trouvés : le Giroflier, le Cannelier, le Muscadier, le palmier Sagon et un grand nombre de genres et d'espèces nouvelles qui sont arrivés en aussi bon état qu'ils le pouvaient être. Cet envoi est le plus considérable et le plus précieux de tous ceux qui ont été faits au Jardin du Roy depuis sa fondation » (p. 194).
En cette fin du XVIIIe siècle, André Thouin, au centre d'un réseau d'information répondant à l'expansion européenne, est représentatif de cet esprit qui prépare la « révolution des savants ». Il entretient « et jusqu'aux antipodes, une correspondance avec des voyageurs, des propriétaires terriens, des diplomates et des souverains » (p. 196). Il participe de cette mobilisation du savoir objectif à la description et à l'arraisonnement du monde, exaltée par l'esprit des Découvertes. De prestigieux botanistes l'ont précédé au Jardin du roi. Parmi ceux qui ont voyagé hors d'Europe : Joseph Pitton de Tournefort, que Louis XIV avait envoyé au Levant en 1700 et qui en revient avec un herbier riche de quelque 1 400 espèces ; Michel Sarrazin, qui, à partir de 1697, collecte au Canada pour le Jardin, en tant que membre correspondant de l'Académie royale ; Joseph de Jussieu, qui fait partie de l'équipe de Louis Godin envoyée en 1735 en Amérique du sud pour "mesurer les degrés sous l'Équateur" (une mission était aussi envoyée en Laponie) et dont les herbiers sont conservés au Muséum… La spécialité de Thouin est la botanique et l'agriculture, mais il est propagandiste d'une entreprise collective qui ne sépare que de manière heuristique les champs du savoir – comme on le voit dans ces expéditions où collaborent : astronome, géographe, physicien, chimiste, naturaliste. Thouin, à l'origine de la dénomination actuelle du Muséum national d'Histoire naturelle, proposera, en août 1790, la création de la section animale. Il rédigera des notes pour l'Assemblée Nationale à propos du statut du Jardin Royal (« Le Jardin Royal n'appartient point au Roi, il appartient à la Nation » argumentera-t-il - p. 268). Il propose de le déclarer « Établissement National » ; de le dénommer « Musaeum français » [appellation adoptée en 1793] ; il lui donne pour but de « réunir la collection la plus complète des objets de la nature dans les trois règnes » ; « il sera composé d'un Jardin, d'un Cabinet d'histoire naturelle, d'une Ménagerie et d'une Bibliothèque ».
L'expédition de La Pérouse, à laquelle Thouin prendra la part essentielle pour la partie botanique, est emblématique de cette passion rationnellement programmée de l'exploration de toutes les formes du vivant. Dans un volume (référencé plus haut) où sont rassemblés les Projet, instructions, mémoires relatifs au voyage de découverte ordonnés par le roi, sous la conduite de M. de La Pérouse, on peut lire : « Le sieur de La Pérouse, dans toutes les occasions, en usera avec beaucoup de douceur et d'humanité envers les différents peuples qu'il visitera au cours de son voyage, s'occupera avec zèle et intérêt de tous les moyens qui peuvent améliorer leur condition en procurant à leur pays les légumes, les fruits et autres arbres utiles d'Europe… » (p. 198). Thouin anticipe les étapes de l'expédition, soit les destinations où adresser le courrier aux voyageurs : « De cette époque [l'expédition lève l'ancre le 1er août 1785] à celle du mois de janvier inclusivement les lettres qu'on écrira aux voyageurs de l'Expédition de M. le Comte de La Pérouse doivent être adressée à Canton, en Chine. Du mois de janvier aux environs de Pâques 1786 on doit les envoyer par la Russie au Kamtchatka. On écrira à Lima au Pérou dans le reste de l'année 1786 par la voie de Cadix. Dans le commencement de l'année 1787 on adressera les lettres à l'Isle de France et enfin, pendant le reste de l'année 1787 on pourra écrire les lettres au Cap de Bonne Espérance poste restante jusqu'à l'arrivée des voyageurs » (p. 220). Le « Mémoire pour diriger le Jardinier dans les travaux de son voyage autour du monde », daté de 1785, est publié dans Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791, Millet-Mureau, L.A., 1797, I, p. 161-188).
L'expédition qui part à la recherche de La Pérouse porte des naturalistes de toutes disciplines. Thouin prépare la logistique de l'exploration botanique. La Nouvelle Hollande, à l'exception de la côte sud-est, où Banks, Solander et Spöring avaient récolté, en mai 1770 à Botany Bay, une grande quantité de spécimens, est inconnue et la perspective de la découverte provoque de nombreuses candidatures. L'introduction à la traduction française de la relation de Sydney Parkinson, peintre de l'expédition de James Cook, résume : « La mer pacifique, ou du sud, a été long-tems peu connue : les Espagnols seuls la traversoient pour aller du Mexique aux Philippines, mais sans s'arrêter dans aucune île. Depuis 1760, les Anglais et les Français y ont fait de fréquents voyages. Les navigateurs les plus célèbres qui précédèrent le capitaine Cook dans cette route difficile, sont le commodore Byron, le capitaine Wallis, le capitaine Carteret, et M. de Bougainville » (Voyage autour du monde sur le vaisseau de sa Majesté britannique l'Endeavour, Paris, 1797, tome premier, p. ij).
Thouin a choisi le jardinier de l'expédition, Lahaye, à qui il prodigue, entre autres instructions, les recommandations suivantes : « Pendant le trajet du Cap à la Nouvelle Hollande, trajet qui ne peut être que très ennuyeux à cause de sa longueur, le jardinier, pour charmer son ennui et mettre le temps à profit, pourra s'occuper à étudier un peu le latin, à essayer de traduire les ouvrages de Linné, à lire le dictionnaire de Bulliard, les ouvrages de Duhamel, et enfin à s'exercer à écrire correctement sa langue » (p. 231). Plus pragmatique, Lahaye reçoit mission de rapporter des mers du Sud l'Arbre à Pain (Artocarpus altilis). « Cet arbre, rapporte Parkinson, est celui qui porte le fruit-pain, si souvent cité par les voyageurs aux îls de la mer du sud ; il peut être justement appelé le soutien de la vie, pour les habitants de ces îles, qui en tirent leur principale nourriture […] en deux ou trous heures de tems, la cuisson [dans un four de terre] est faite, et ce fruit offre alors un aliment plus flatteur à l'œil que le plus beau pain que j'aie vu de ma vie […] » (Voyage autour du monde…, 1797, par Sidney Parkinson, p. 82). « S'il parvient à nous enrichir de cet arbre précieux, écrit Thouin il fera à sa patrie le plus utile de tous les présents, et à lui seul il aura plus fait pour le bonheur des hommes que tous les savants du monde » (p. 234). La dernière lettre de Collignon, le jardinier de l'expédition La Pérouse à Thouin, rapportait que « l'Angleterre avait envoyé à Othaïti un vaisseau exprès muni d'une serre chaude pour transporter plusieurs plantes intéressantes de ces parages et particulièrement l'Arbre à Pain » (p. 226). L'arbre en question est prélevé par Lahaye sur l'île de Tongatapou mais, après le décès d'Entrecastaux, le nouveau capitaine, royaliste, livre les navires, ses compagnons et sa cargaison aux Hollandais en abordant à Java. Sur l'intervention de Banks, les collections seront restituées aux Français. Banks conclut son message qui accompagne la restitution d'un « That the science of two nations may be at peace while their politics are at war » (p. 242). Dans son discours à la mémoire de Thouin, prononcé en juin 1825 à l'Académie des sciences, Cuvier pourra dire : « Les instances et les directions de Thouin firent réussir l'arbre à pain à Cayenne où il donne des fruits plus beaux que dans son pays natal » (p. 244). Lahaye, jardinier-voyageur formé à l'école de Thouin, s'est acquitté scrupuleusement de sa difficile (et périlleuse) mission : de surcroît à l'arbre à pain, il rapporte 50 espèces d'Australie, 700 de Java et 110 de l'Isle de France…
La Révolution « consacrant l'égalité entre les hommes que l'Europe savante met sur le même rang » supprimera « la place d'intendant du Jardin des plantes et du Cabinet d'Histoire naturelle », selon le vœu de Thouin. Le successeur de Buffon, La Billardrie ayant suivi les émigrés (il démissionne le 31 décembre 1791), la place est occupée par Bernardin de Saint-Pierre qui se révèle, à lire les demandes répétées qu'il adresse au ministre de l'Intérieur, principalement attentif à ses intérêts. « Il a possédé cette place, écrit Thouin jusqu'au10 juin 1793, jour où elle a été supprimée par un décret de la convention nationale » (p. 281), conformément à la volonté des officiers des différents services réunis autour de Daubenton, à l'insu de La Billardrie, en 1788. « L'arbre de la liberté serait-il le seul qui ne pût pas être naturalisé au Jardin des plantes ? » demande Thouin dans son adresse du 20 août 1790 à l'Assemblée Nationale (p. 261).
Au Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature, de Charles-Joseph Panckoucke, publié à partir de 1788 (avec qui Thouin collabore), répond évidemment l'étude du « quatrième règne », celui de l'homme. L'objet : « …débrouiller, s'il est possible, les Archives du Genre-humain, et étudier la Nature encore dans son berceau » (Discours préliminaire ou introduction au Zend-Avesta, 1771, p. ij).
Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
"Je n'ai jamais été d'aucune utilité aux Comptoirs François de l'Inde."
Pour présenter – et résumer – Hyacinthe Anquetil-Duperron, il suffira d'un extrait d'une lettre, écrite en 1804 (Paris, 28 mai 1804 - 8 prair. An XII) quand il est demandé aux membres de l'Institut de prêter serment de fidélité à l'empereur (il sera le seul, avec La Révellière-Lépeaux, dont il a été fait mention plus haut, à refuser de prêter serment). S'excusant de ses expressions « si elles ont quelque chose de dur et d'agreste », il déclare :
« Je ne jure ni ne jurerai fidélité à l'Empereur, comme on n'a pas droit de l'exiger d'un Français, simple particulier, sans places ni fonctions » et argumente : « Monseigneur, Je suis homme de lettres, et ne suis que cela, c'est-à-dire un zéro dans l'État. Je n'ai jamais prêté serment de fidélité, ni exercé aucune fonction civile ni militaire : à 73 ans, prêt à terminer ma carrière, qui a été laborieuse, pénible, orageuse, je ne commencerai pas : la mort m'attend ; je l'envisage de sang-froid. Je suis et serai toujours soumis aux lois du gouvernement sous lequel je vis, qui me protège. Mais l'âme que le Ciel m'a donnée, est trop grande et trop libre, pour que je m'abaisse et me lie en jurant fidélité à mon semblable. Le serment de fidélité, dans mes principes, n'est dû qu'à Dieu, par la créature au créateur. D'homme à homme il a à mes yeux un caractère de servilité auquel ma philosophie indienne ne peut s'accommoder. » (Cette lettre est publiée par Raymond Schwab, Anquetil-Duperron, Paris : Leroux, 1934, p. 122-123).
Autant Thouin est-il apprécié, on l'a vu, pour son hospitalité, sa modestie et son urbanité, autant Anquetil se révèle-t-il impulsif et indépendant. Faisant le bilan de ses deux premières années de séjour en Inde, il s'étonne lui-même du tour pris par sa quête scientifique : « Surpris moi-même des travers dans lesquels j'avais donné, ce qui me touchait le plus était la perte de deux années et la crainte de voir la guerre mettre obstacle à l'ardeur raisonnée dont je me sentais animé » (Zend-Avesta, I. p. cxxij). A son arrivée à Pondichéry, le 9 août 1755, on lui propose une place d'interprète qu'il décline. Il raconte et argumente :
« Plusieurs personnes me montroient en perspective la fortune d'un Conseiller, qui, par les Persan moderne, avoit trouvé le moyen, en qualité d'Interprète, de gagner plus de quatre Lacs (plus d'un million). Mais suivre ce parti, ç'eût été renoncer à mes voyages dans les terres, aux Découvertes que je voulois faire. D'ailleurs le personnage mercenaire et comme instrumental d'Interprète, ne s'accordoit pas avec la liberté de mon caractère » (id., p. xxv). Il commente : « Mon arrivée et le sujet de mon voyage firent quelque bruit dans un pays où l'on ne voyoit que des personnes attirées par l'amour du gain, par le désir de réparer les débris de leur fortune ou obligées en quelque sorte de s'expatrier pour étouffer les suites d'une conduite trop déréglée pour l'Europe » (id., p. xxiv). Faisant le bilan de son séjour, il conclut : "Je n'ai jamais été d'aucune utilité aux Comptoirs François de l'Inde" (id., p. xxv). (« Que savons-nous des Indes orientales, s'interrogera Jean-Jacques Rousseau, fréquentées uniquement par des Européens plus curieux de remplir leurs bourses que leurs têtes » - Discours…, note 10, p. 321, voir infra).
Sa détermination et son courage ne sont pas moins exceptionnels que sa « liberté de caractère ». Il s'engage comme simple soldat, à vingt-trois ans, dans la troupe de la Compagnie des Indes et son périple indien, solitaire et périlleux, démontre une volonté animée par une curiosité tous azimuts. Cette liberté d'esprit le met souvent dans des situations difficiles. Notamment avec les européens attachés aux compagnie de commerce. C'est d'abord une distance morale et philosophique avec ceux-ci. Il écrira dans sa Législation orientale : « Un particulier, marchand, homme d'Etat, militaire, homme de lettres même, plein des idées qu'il s'est formé de l'excellence des gouvernements européens, passe dans l'Inde, toujours pour faire fortune, c'est-à-dire pour amasser en quatre ans, ce que sa patrie ne lui donnerait pas en vingt. Les difficultés qu'il éprouve en arrivant l'aigrissent. Le militaire est arrêté dans ses conquêtes par ce qu'il appelle une troupe de Noirs. Quel scandale ! Le dernier de ses soldats se croit plus que leur chef. » (Législation orientale ..., Amsterdam : Marc-Michel Rey, 1778, p. 31). A Chandernagor : il provoque une « émeute » parmi les officiers qui ont pu lire à son insu les notes de son agenda où « observateur par goût et par état [il] avait coutume [de] marquer les lieux, les évènemens, ajoutant quelquefois un mot de réflexion, pour [se] les rappeler plus aisément. Furieux de me voir si bien instruit, et peut-être de trouver dans ce Brouillon plusieurs traits trop bien calqués sur le vrai, tous élèvent la voix contre moi » (p. xlviij). Law de Lauriston, chef de la loge française de Qasimbazar rapporte l'affaire ainsi : « Arrivés à Calegon, nous avions avec nous, un nommé Anquetil, jeune homme d'esprit, observateur mais critique plus qu'il ne convenait. Le corps des officiers m'ayant porté de fortes plaintes sur les observations que le hasard leur avait procuré, il prit le parti de nous quitter. Les esprits étaient d'autant plus animés contre lui que sa conduite à Chandernagor, d'où, la veille de l'attaque des Anglais, il était parti sans prévenir qui que ce soit, avait déplu singulièrement. Je lui fis remettre sept ou huit roupies d'or… » (Law de Lauriston, Mémoire sur quelques affaires de l`empire mogol 1756-1761, publié par Alfred Martineau, Paris : Champion-Larose. 1913, p. 155). A Goa : il s'emporte devant l'abondance d'ecclésiastiques, « monde de Prêtres, Moines, Chanoines, etc. Noirs et Blancs ; vraies Sauterelles des Colonies » (p. ccvj). Séjournant à Surate, il a un duel avec un mari jaloux (p. cccxxxj) ; le nouveau mari de la veuve souhaitant le voir composer, il marque : « Jamais on n'a rien tiré de moi par menaces, et d'ailleurs, dans l'Inde comme en Europe, je n'ai jamais eu ni désiré rien au-delà du nécessaire » (p. ccccxxxj). Alors qu'il cherche à quitter Surate et qu'il apprend qu'un vaisseau suédois doit retourner en Europe par la Chine, il se propose de s'« enfoncer dans l'Empire de la Chine, ou dans le Thibet ». « Cette idée, note-t-il, me rendoit mes premieres forces, et effaçoit absolument de ma mémoire les peines et les fatigues que j'avois essuyées depuis huit ans » (p. ccccxxx).
C'est donc, dans le sillage des compagnies de commerce, un autre intérêt, singulier, qui anime Anquetil. « Je me rappelle avec complaisance certains traits de mes voyages dans les terres : hommes et femmes me demandoient, voyant que je n'étois ni militaire, ni marchand, ni missionnaire, ce que j'étois venu faire dans l'Inde. Vous voir, leur disois-je. Ils me regardoient avec étonnement, avec attendrissement, vivement frappés de ce que les échos répétoient au loin, de la rapacité brutale des Européens ; et tous s'empressoient de me servir (L'Inde en rapport avec l'Europe, t. I, p. 344).
L'apport scientifique
Anquetil fait des études de théologie à la Sorbonne, puis étudie les langues orientales, principalement l'arabe et le persan, dans les séminaires jansénistes de Hollande qui formaient missionnaires et interprètes pour le commerce, la mission et la diplomatie. De retour à Paris, il se documente à la bibliothèque du roi qui possède un fonds de manuscrits orientaux, dont des manuscrits sanscrits, notamment adressés par le P. Pons, auteur d'une grammaire et d'un lexique. Ce fonds ne comporte aucun manuscrit en vieux perse. Anquetil rapporte que sa vocation scientifique est née de l'exaltation qu'il a éprouvée à la vue de quelques lignes reproduites d'un manuscrit perse non déchiffré. » En 1754, j'eus l'occasion de voir chez M. Leroux Deshauterayes quatre feuillets du Vendidad Sadé, qui avoient été envoyés d'Angleterre à M. Fourmont. Sur le champ, je résolus d'enrichir ma patrie de ce singulier ouvrage. J'osai former le dessein de le traduire, et d'aller dans cette vue apprendre l'ancien Persan dans le Guzarate ou dans le Kirman. Ce travail pouvoit étendre les idées que je m'étois faites sur l'origine des langues et sur les changements auxquelles elles sont sujettes. Il étoit encore de répandre sur l'Antiquité Orientale des lumières que n'avoient point eues les Auteurs Grecs et Latins » (Journal des Savants, juin 1762, p. 415). Dans ce qu'il appelle lui-même un « coup de tête » dans sa lettre de remerciement au comte de Caylus, alors qu'il est arrivé à Lorient, datée du 15 décembre 1754, où il conjecture : « Que sait-on ? ces livres sacrés et impénétrables, même aux naturels, renferment peut-être la liaison de l'histoire des Indes à celle des Grecs. » (Lettres inédites d'Henri IV, et de plusieurs personnages célèbres, tel que Fléchier, La Rochefoucauld, Voltaire, le comte de Caylus, Anquetil-Duperron, etc., Paris : Tardieu an X, 1802, p. 218-219) tient la vocation d'une vie.
Il opte pour l'Inde. Ces textes anciens, il peut en effet les trouver à Surate, sur la côte nord-ouest de l'Inde. Mais, après avoir débarqué à Pondichéry, il se rend au Bengale et n'arrivera à Surate qu'au terme d'un périple de deux années, rapporté dans le premier volume de sa traduction du Zend-Avesta, alors que Français et Anglais sont en guerre. A la fin de ce premier tome, ayant dressé la liste des manuscrits réunis (il en rapportera cent quatre-vingts), Anquetil reste insatisfait : « Voyageurs instruits et courageux, ne prenons plus la portée de notre vue pour la mesure de l'univers, osons franchir les Ghâtes, les Cordillères, pour savoir où nous en sommes de notre route : le sommet de ces hautes montagnes nous montrera l'espace immense qui nous reste à parcourir » (Zend-Avesta, I, p. Dxlj-Dxlij). Au plan professionnel, ce travail de pionnier se révèle être dépendant de ses sources. Anquetil apprend l'avestique auprès d'un dastour de la communauté parsie établie à Surate, Darab, la prise de Kirman, au début du XVIIIe siècle, ayant dispersé les parsis fidèles à Zoroastre en plusieurs foyers qu'opposent des conceptions liturgiques et doctrinales. Pour stimuler ses informateurs et confronter ses sources, Anquetil utilise les dissensions entre orthodoxes et réformistes. « Je le menaçai de l'abandonner, lui [Darab] et Kaous, son parent, à Mancherdji, leur ennemi capital, s'il refusoit de m'aider à traduire le Vendidad en Persan moderne. Le stratagème réussit » (p. cccxxix). On mesure l'âpreté de la quête d'Anquetil et la pression mise sur ses sources quand, ayant obtenu du chef de la communauté opposée à son principal informateur, courtier au service de la loge hollandaise, un autre manuscrit que celui-ci veut à toute force récupérer, il le conserve pendant quatre mois afin d'en relever les différences avec celui de « ses Destours », malgré la menace « de venir chez [lui] avec une troupe de soldats [hollandais], enlever le Manuscrit en question ». Anquetil rapportera à ce propos : « La seule précaution que je pris, fut d'avoir sur ma table deux pistolets chargés ; et je continuai mon travail qui dura quatre mois après lesquels je renvoyai le Manuscrit en bon état » (p. cccxxix-cccxxx).
« Après trois mois de séjour à Surate, écrit-il, je reçus enfin le Manuscrit [que mes Docteurs] m'avaient promis. C'étoit le Vendidad, vingtième volume de leur Législateur, volume in 4°, écrit en Zend et en Pehlvi » (p. cccxiij-cccxiv). « Me sentant assez fort pour commencer les livres zends et impatient de regagner les mois que j'avais vu s'écouler au milieu des troubles, je passai quelques jours à m'affermir dans la lecture du Vendidad et à traduire sur le persan interlinéaire, le Vocabulaire pehlvi et persan, dont j'ai parlé plus haut. Ce travail, le premier qu'un Européen eût jamais fait en ce genre, me parut un événement dans la littérature et j'en marquai l'époque qui fut le 14 Mars 1759 de J.-C., le jour Amerdad, six du mois de Meher de l'an 1128 d'Iezdedjerd, l'an 1172 de l'Hégire et 1813 du règne du Rajah Bekermadjit » (p. cccxxx).
Les manuscrits avestiques qu'Anquetil traduit et rapporte en Europe, transcrivant deux langues différentes à l'aide d'une même écriture, se révèlent d'une interprétation particulièrement difficile. Leur authenticité cessera d'être discutée (le chapitre de l'ouvrage de Schwab, intitulé « La querelle de l'Avesta », traite exhaustivement la question) quand Eugène Burnouf proposera une nouvelle traduction d'un manuscrit de la collection d'Anquetil (le Vendidad Sade, publié de 1829 à 1843) et que les progrès de la grammaire comparée auront mis en évidence la parenté de l'avestique et du sanscrit. La quête d'Anquetil, décidée sur une illumination, s'avère donc fructueuse. « J'avais passé près de huit ans hors de ma patrie, et près de six ans en Inde. Je revenois en 1762, plus pauvre que lorsque je partis de Paris en 1754, ma sobriété ayant suppléé dans mes Voyages, à la modicité des mes appointemens. Mais j'étois riche en Monumens rares et anciens, en connoissances que ma jeunesse (j'avois à peine trente ans) me donnoit le tems de rediger à loisir ; et c'étoit toute la fortune que j'avois été chercher aux Indes » (p. cccclxxviij). Après les spéculations des philosophes sur la langue originelle, on peut considérer qu'avec la première traduction du Zend-Avesta de 1771, l'histoire (européenne) de la linguistique commence…
Au-delà de cet apport à la connaissance d'un texte sacré de l'Orient, l'œuvre d'Anquetil se caractérise par la conviction qu'on ne peut borner le savoir aux classiques et à la tradition biblique, et par sa volonté d'élargir l'horizon de la pensée savante en conséquence. Anquetil est en cohérence avec la renaissance des Lumières qui ajoute à la découverte des Anciens celle des autres humanités. Le P. Pons écrivait, en 1740 : « La grammaire des Bramines peut être mise au rang des plus belles sciences ; jamais l'analyse et la synthèse ne furent plus heureusement employées que dans leurs ouvrages grammaticaux de la langue sanscrite ou samskretam » (cité par Filliozat, Bibliothèque Nationale, département des manuscrits, Catalogue du fonds sanscrit, Libr. d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, 1941, t. 1, p. 5). Dans sa préface au Zend-Avesta, Anquetil constate : « Ce qui regarde les Juifs, les Grecs, les Romains, l'Europe entière, fait, depuis la renaissance des Lettres, l'étude des Sçavans : restent l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, qui, si j'ose le dire, sont encore à découvrir dans le sens que j'ai expliqué plus haut » (p. x). La préface de la Législation orientale interpelle « A propos de la science présomptueuse des Européens » : « Elevés dans la connaissance de quatre à cinq cent lieues de pays, le reste du globe nous est étranger. Comme nos esprits ont cultivé en apparence tous les genres, que les arts ont donné à nos sens tous les plaisirs dont ils paraissaient susceptibles, que notre philosophie s'est exercée sur toutes les situations analogues à notre position, à nos mœurs, nos opinions, il résulte de là un repos mortel qui nous empêche d'aller plus loin. Que nous apprendraient, en effet, des étrangers qui boivent, s'habillent, se marient, élèvent leurs enfants, vivent en société ! Nous savons là-dessus tout ce que nous ont transmis les Grecs et les Romains ? Nous entendons les langues de ces deux peuples. Est-il besoin d'autres lumières ? » (1778, p. 4) A l'inverse de cette présomption, la Législation se donne un programme qui pose l'égalité des civilisations (p. VI) : « Je suis homme, j'aime mes semblables ; je voudrois serrer davantage les nœuds par lesquels la nature unit l'espece humaine, et que la distance des temps et des lieux, et la variété des langues, des usages et des opinions n'ont que trop relâchés, s'ils ne les ont pas entierement rompus ».
Anquetil choisit donc l'Inde et non le Kirman pour destination. « Je sçavois encore que les quatre Vedes, Livres sacrés des Indiens, étoient écrits en ancien Samskretam ; et que la bibliothèque du roi étoit riche en manuscrits Indiens que personne n'entendoit. Ces raisons m'engagèrent à préférer l'Inde au Kirman d'autant plus que je pouvais également y approfondir l'ancien Persan et l'ancien Samskretam […] Et je m'embarquai le 24 février 1755, pour les Indes Orientales, avec la résolution d'en rapporter les loix de Zoroastre et celles des Brames » (Journal des Savants, juin 1762, p. 416). Anquetil compte parmi les pionniers de l'exploration du fonds culturel dit « indo-européen ». Il annonçait dans sa relation abrégée, dès 1762, de retour d'Inde : « Ce travail pouvoit étendre les idées que je m'étois faites sur l'origine des langues et sur les changement auxquelles elles sont sujettes. Il étoit encore de répandre sur l'Antiquité Orientale des lumières que n'avoient point eues les Auteurs Grecs et Latins » (id., p. 415). L'indianiste Sylvain Lévi pourra écrire : « Anquetil-Duperron marque plus qu'une date ; il ouvre une ère nouvelle dans l'histoire de l'intelligence humaine […] il inaugure, dans l'Inde d'après Dupleix, les conquêtes de la science sur les énigmes du passé » (Préface à Raymond Schwab, Anquetil-Duperron, Paris : Leroux, 1934, p. V). La découverte de ce fonds commun ouvre sur la question de l'origine des civilisations orientales – et des langues indo-européennes.
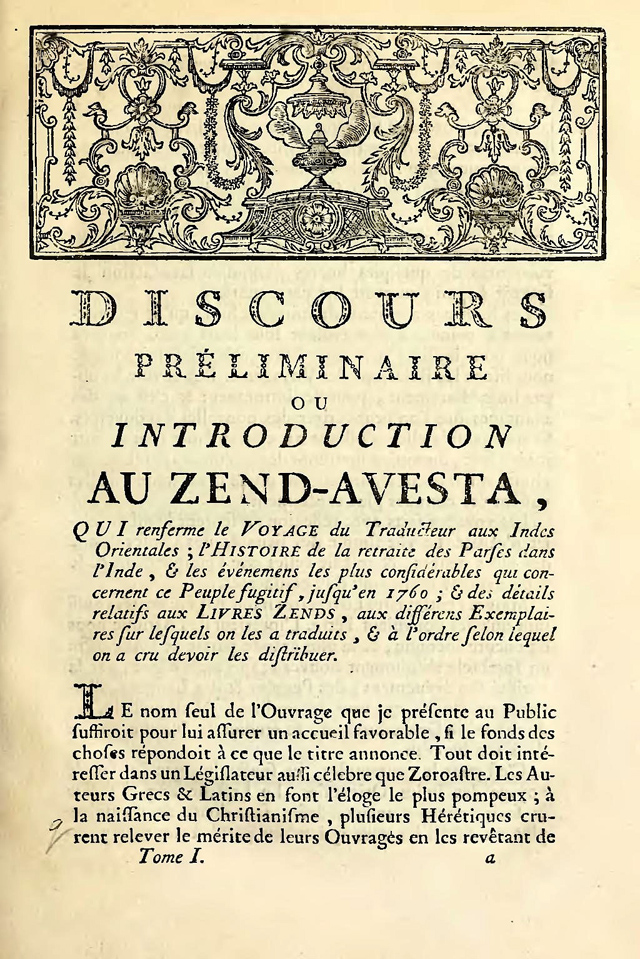
Esprit original et indépendant, Anquetil est un savant solitaire, mais nullement isolé scientifiquement. Il a bénéficié, tout au long de sa carrière de protections efficaces et, membre de l'Académie puis de l'Institut, il fait partie d'un réseau de correspondants qu'il enrôle, tel le P. Cœurdoux, pour son savoir et sa présence ancienne en Inde. L'Académie attend de Cœurdoux dictionnaires, grammaires (« Je fais copier, répond par exemple celui-ci dans lettre datée du 10 février 1771, ce qui vous manque de la grammaire Samskrétane : c'est un bon ouvrage, dont on est redevable au P. Pons. J'ai trouvé avec bien de la peine un écrivain pour copier le petit dictionnaire Télégou-François et Samskrétam ; mais l'ouvrage va bien lentement »… - p. 687) ainsi que des éclaircissements sur des points d'histoire et de théologie indienne. Anquetil proposera au missionnaire de se porter candidat à une place de correspondant de l'Académie des belles lettres. Celui-ci lui décline malicieusement cette dignité : « Quant au titre de correspondant [qu'il fallait demander pour être élu], je connois tout le prix de cet honneur ; mais s'il étoit mendié de ma part, je pense qu'il cesseroit de me décorer » (voir infra, p. 690)… Anquetil publiera sa correspondance avec Cœurdoux (Mémoires de l'Académie des inscriptions, 1808, tome 49, p. 647-712) entretenue pendant huit ans, dit-il (1768-1773, officiellement, quoique ses notes fassent état d'une réponse en 1775 : p. 712) afin de « familiariser » le public avec « les matières de l'Inde » (théologie, histoire, langues) et « des pays que jusqu'ici on n'a guère envisagés que sous le regard du commerce et des possessions territoriales » (p. 647). Il ajoute des commentaires en bas de page aux notes du missionnaire (qu'il signale comme telles).
Cet échange Cœurdoux-Anquetil-Barthélémy constitue les prémisses des recherches sur les langues indo-européennes. Un état du savoir partagé par une communauté scientifique élargie aux limites de l'expansion européenne et spécifiquement argumenté, en l'espèce, par les analyses du P. Cœurdoux. Le P. Cœurdoux répond à la question, « proposée à M. l'abbé Barthélémy et aux autres membres de l'Académie de Belles-Lettres et des Inscriptions » : « D'où vient que, dans la langue Samskroutane, il se trouve un grand nombre de mots qui lui sont communs avec le latin et le grec, et surtout avec le latin ? » Il produit plusieurs listes de mots pour illustrer cette « communauté » ainsi que des « remarques » touchant à la construction et à la prononciation du sanscrit, mettant notamment en évidence des règles et des évolutions phonétiques qui justifient des « étymologies » où la « ressemblance [...] paroîtra tirée de trop loin ». Cette analyse anticipe la loi de mutation phonétique (Lautverschiebung) qui sera mise en évidence par Grimm en 1822. L'origine commune des termes étant établie par les caractéristiques phonétiques propres au sanscrit, s'élève évidemment la question : « Comment expliquer cette improbable communauté linguistique entre des peuples si distants et si différents ? » On peut invoquer, propose alors Cœurdoux, « six causes » possibles à cette similitude et l'imputer : « au commerce, aux sciences, au voisinage des pays, à la religion, à la domination, à une commune origine, ou à plusieurs de ces causes réunies ». Il retient celle de la commune origine, développée dans le récit biblique de la dispersion des hommes. « Et ne seroit-ce pas là le dénouement simple de la question proposée ? Plusieurs termes communs restèrent dans les langues nouvelles ; un grand nombre se sont perdus par le laps du temps ; d'autres ont été défigurés à un point qu'ils ne sont plus reconnoissables. Quelques-uns ont échappé à ce naufrage, pour être aux hommes un mémorial éternel de leur commune origine et de leur antique fraternité » (p. 664). Anquetil ajoute ce commentaire à la thèse de Cœurdoux : « Je crois que le sentiment du savant missionnaire est vrai ; il a toujours été le mien. C'est ce qui m'a lancé dans l'étude des langues, le fil qui m'a conduit au milieu du labyrinthe que forment leurs divergences. J'en dis autant des premières vérités, des opinions religieuses » (p. 664).
Pour appuyer cette thèse, Cœurdoux s'appuie sur ce que la tradition indienne dit sur l'origine des brahmanes, ainsi que sur les différences phénotypiques observables. « C'est un fait qui aux Indes ne souffre pas le moindre doute, que les Brahmes viennent du nord ; et encore aujourd'hui, ceux qui sont nés dans des pays plus septentrionaux, se regardent comme supérieurs aux méridionaux. La couleur des Brahmes est bien moins basanée que celle des autres Indiens, ce qui indique leur lieu d'origine. C'est aux sources du Gange et dans le mont Caucase qu'il faut aller chercher les premiers Brahmes, leurs savans, leurs philosophes, leurs pénitens, leurs solitaires. Tous les livres de l'Inde ne font mention d'autre chose. Calanus, ce philosophe Indien qui se brûla lui-même tout vivant, étoit né, dit Cicéron, ad radices Caucasi » (« au pied du Causase »). C'est là, au Maham Merou, que la tradition situe le lieu de béatitude de Brahma et où retournent les brahmes après leur mort (p. 665). « Il paroît que c'est de Japhet que descendent les brahmes ; ils reconnoissent pour chefs de leur race, sept fameux hommes ou pénitents mariés, qui furent sauvés seuls du déluge, dans un vaisseau : ce sont les sept fils de Japhet. » (p. 666) « Ces sept hommes fameux, semblables aux anciens patriarches […] furent enfin transportés au ciel, dans la partie nord, et transformés dans les sept principales étoiles de la grande ourse » (p. 666).
C'est donc une commune origine de « frères » aujourd'hui séparés qui explique la parenté linguistique en cause et un lent processus d'émigration radiale (de dispersion) qui en explique les différences, caractéristiques du phénomène de dérive linguistique, d'autant plus accusées que la distance géographique et culturelle entre les « frères » a crû avec le temps. « Les hommes ne s'avançoient que peu à peu vers les pays qui leur étaient destinés, et cela ne pouvait être autrement ; hommes, femmes, enfants, malades, tout marchoit ensemble, et il falloit pourvoir aux besoins de tous. Ces grandes familles, quoique séparées les unes des autres, avoient sans doute, sur-tout dans les commencements, beaucoup de communications entre elles ». (p. 664-665). Dans une lettre à Cœurdoux datée 28 juillet 1768, Anquetil se déclare en phase avec la thèse du missionnaire, proposant l'expression de langue-mère pour qualifier cette commune origine : « En général, je crois avec vous que quelques ressemblances ne prouvent pas l'emprunt, et que plusieurs mots communs à des langues en usage dans des pays fort éloignés les uns des autres, ont pu venir d'une première langue, mère de celles-ci » (p. 671). Il avait noté au préalable son accord général : « Il y a long-temps, mon R. P., que j'ai les mêmes idées que vous […] sur l'identité que l'on prétend trouver entre les coutumes de peuples les plus éloignés les uns des autres » (p. 670). A propos du lent processus de migration évoqué par Cœurdoux, Anquetil légitime le propos par une comparaison contemporaine : « La population augmentant les poussoit naturellement vers les pays inhabités, comme nous voyons les Etats-Unis passer les Apalaches, et se porter vers le Mississipi » (note e, p. 665).
Il y a donc une explication canonique à ces migrations à partir d'un même site : la Bible, considérée comme un livre d'histoire. Cette communauté de langue, qui se révèle être aussi une communauté de culture (rapporté au Noé biblique, au Manouvou indien, ou à Outa-Napishtin de l'épopée de Gilgamesh, le Déluge apparaît comme un même événement), authentifie sans doute le récit biblique. Mais il en relativise aussi l'unicité et le caractère sacré et ce, d'autant que les traditions en cause sont bien antérieures à la Bible et que, pour ce qui concerne le compte du temps, la précision et la certitude sont du côté indien. « Pour les signes du zodiaque, les Indiens ont les mêmes que nous », notait Cœurdoux (p. 687). La lettre intitulée dans l'édition d'Anquetil « Des sciences des Brahmes solitaires, et de l'époque du Déluge , par le P. Cœurdoux » précise ce savoir-faire. Selon le comput indien nous vivons le quatrième âge, appelé Caliyougam, dont le commencement « est précisément la fin du déluge, très-distinctement marqué dans tous les livres Indiens […] Or voici une nation dont l'antiquité ne peut être révoquée en doute ; nation qui n'est jamais tombée dans la barbarie comme tant d'autres […] qui dit qu'elle est à telle année de sa période de 60 ans, et qui compte combien il y a eu de ces périodes d'écoulées depuis le déluge. Combien de choses regarde-t-on comme certaines en matière de faits historiques, qui n'ont pas de si solides fondemens ! » (p. 693). « Il seroit bien inutile de rechercher si [le cycle de 60 ans] étoit en usage avant le déluge, et si c'est de Noé ou de ses fils que les Indiens l'ont reçu. Ce qui est sûr, c'est que le cycle hebdomadaire étoit connu et suivi dans la pratique, dès avant le déluge ; que les Indiens l'ont comme nous et les Hébreux, et que les jours de la semaine Indienne tombent juste avec les nôtres, et ont le mêmes noms, mais en langue différente » (p. 694). Anquetil cite alors, pour appuyer l'analyse de Cœurdoux, l'ouvrage de Le Gentil, « astronome de l'Académie des sciences », statuant « qu'il est hors de doute que dans le 1er siècle de l'ère Chrétienne, la période de 60 ans étoit en usage chez les Brahmes et les philosophes de l'Inde ; d'où l'on peut inférer qu'elle étoit connue long-temps avant » (p. 696).
Avec la figure d'Anquetil-Duperron, c'est le profil du savant ouvert à la compréhension des autres cultures tel que l'idéal en est formé – en théorie – dans les Considérations de la « Société des observateurs de l'homme » qui se dessine. Avec ses limites. A propos des Parsis, Anquetil note : « On seroit surpris de voir les Disciples d'un Législateur dont les Ouvrages donnent de la Divinité les idées les plus sublimes […] de les voir aussi peu frappés de ces objets, tandis qu'ils ont un attachement servile pour les pratiques qui forment l'extérieur de leur culte ». Leurs « Cérémonies, les Usages, sont comme des livrées, qui les séparent du reste du genre humain, et qui leur disent continuellement, qu'ils sont les vrais, les seuls Serviteurs d'Ormuzd, de l'Etre Suprême. Tel est le motif qui soutient une Religion même opprimée » (p. cccclxxxj). Il serait naïf de penser que cette ouverture épistémologique préserve ces découvreurs de la conviction de la supériorité de leurs propres croyances – pour autant que la chose soit possible. Œuvrant à la compréhension de l'origine commune des traditions orientales et du récit biblique, le P. Cœurdoux s'exclame : « Pour trouver le Sauveur du monde dans la plus infâme divinité de l'Inde, on commence par estropier son nom » [qui s'orthographie « Crichnen » et non « Chrichnen »] (p. 681). Comme il a été rappelé ici (Les compagnies des Indes : Fragments d'histoire, le contact des religions), ce savant mettra personnellement la main à la destruction d'un temple de Siva à Pondichéry.
Apostille : le miel et l'aloès
"Referme ton Coran. Pense et regarde librement le ciel et la terre."
(Omar Khayyâm - 1048-1122)
Rubayat
S'il est permis de mettre en perspective ces fondations avec l'exercice ordinaire de l'anthropologie, aujourd'hui, on peut remarquer qu'un certain nombre de propriétés formelles communes (dont le rappel conclura cette page d'histoire) apparaissent dans ces aventures pionnières.
L'anthropologie occidentale procède d'un environnement historique et social déterminé, celui de l'expansion européenne. Portée par cette expansion – avec ses vicissitudes – elle a aujourd'hui pour idéal un horizon du savoir dans lequel les différentes formes d'humanité seraient répertoriées sans hiérarchie. C'est aux inventeurs évoqués ci-dessus que l'on doit l'idée, devenue banale, d'un monde commun, « vingt peuples et quarante siècles », selon le mot d'Abel Rémusat (« Discours sur le génie des peuples orientaux », Mélanges posthumes d'histoire et de littérature orientales, 1843, p. 221), révélés par le déchiffrement des écritures et les découvertes des expéditions scientifiques. Un personnage de Balzac, Louis Lambert, peut ainsi argumenter : « – Il est impossible de révoquer en doute la priorité des Écritures asiatiques sur nos Écritures saintes. Pour qui sait reconnaître avec bonne foi ce point historique, le monde s'élargit étrangement ». Et de conclure : « L'anthropogonie de la Bible n'est donc que la généalogie d'un essaim sorti de la ruche humaine qui se suspendit aux flancs montagneux du Thibet, entre les sommets de l'Himalaya et ceux du Caucase » (Histoire intellectuelle de Louis Lambert, 1837, p. 95)… Ce monde ouvert par l'exploration et par le savoir (à parfaire…) donne son double objet à l'enquête anthropologique : unité de l'homme, diversité des cultures.
Si les sciences de l'homme ont pour modèle les sciences naturelles, le « facteur humain » en spécifie évidemment le propos. On ne peut simplement voir l'autre homme comme s'il n'était pas un homme. Et c'est à travers la « boîte noire » de sa culture et de ses émotions que le voyageur l'appréhende. Les Grecs surnommaient Hérodote philobarbaros, l'amateur de barbares (Plutarque, Œuvres morales, 37). Quand l'exclusivisme ordinaire est la règle et la xénophilie l'exception, l'anthropologie paraît systématiser cette curiosité naturelle de l'homme pour l'homme et cette interpellation de l'altérité. Il faut sans doute une pulsion particulière faite d'incomplétude et d'embarras du domestique pour satisfaire à ce métier qu'on peut exercer sans l'avoir appris et où l'intérêt humain (et autres paramètres personnels) tiennent lieu de sauf-conduit. Deux types de vocation surgissent dans ce sillage de l'expansion européenne. Quand l'enquêteur marque un intérêt spécifique, parfois exclusif, pour une culture dont la compréhension (et parfois le partage) motive son engagement. Et quand, moins particulier dans son inclination, il nourrit un intérêt générique pour la diversité culturelle, se donnant pour objet de représenter l'unité éclatée du genre humain. Ces deux approches sont complémentaires, en réalité. L'anthropologie sans ethnologie est vide ; l'ethnologie sans anthropologie est aveugle. L'engagement du premier type n'est pas nécessairement un gage d'objectivité, d'exhaustivité ni même de fidélité à la culture élue ; la généralité visée par le second type reste métaphysique si l'émotion de la différence n'en mobilise pas le propos. Lorsqu'il est sur le terrain, l'ethnologue s'interroge inévitablement non seulement sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Au-delà de la différence des croyances, des valeurs et des usages, il ne peut qu'être frappé, où qu'il aille (partageant, par exemple, le mil, le vary hosy ou le massalé…) par la plénitude de la vie sociale et par la fraternité des hommes, lorsque ceux-ci ont la possibilité de s'épanouir dans les conditions de vie qui leur sont naturelles. Il n'y a pas de degré dans ce qui fait, universellement, le prix de la vie humaine. La remarque d'Adam Smith sur l'égalité des jouissances malgré l'inégalité des conditions peut s'appliquer aux différentes cultures. « Pour ce qui constitue le véritable bonheur de la vie humaine, il n'y ni inférieurs ni supérieurs. Tous les rangs de la société sont au même niveau pour le bien-être du corps et la sérénité de l'âme, et le chemineau qui se chauffe au soleil le long d'une haie, possède ordinairement cette paix et cette tranquillité pour laquelle les rois combattent » (The Theory of Moral Sentiments, the second edition, Londres et Edinburgh : Millar et Kincaid, 1761, IV, p. 274).
Du premier cas de figure (l'adhésion, avec ses paradoxes) on pourrait donner en illustration George Catlin (1796-1872). Il abandonne une carrière d'avocat pour peintre les Indiens dans leur milieu. Il leur consacre sa vie. « Je suis devenu si indien que mon crayon a perdu tout appétit pour les sujets qui ont des relents de domesticité (tameness) » (Letters and Notes on the Manners, Customs, and Condition of the North American Indians, 1841, II, p. 37). Fascination pour les vertus et la splendeur des Indiens : incompréhension totale de leurs croyances et de leurs rituels. Du berdache, par exemple, Catlin note : « C'est l'une des coutumes les plus incompréhensibles et les plus dégoûtantes que j'aie jamais rencontrées en pays indien […] Et pour un compte-rendu plus détaillé je suis contraint de renvoyer le lecteur vers les régions où elle s'observe et où, je l'espère, elle va disparaître avant qu'elle ne puisse être rapportée de manière plus exhaustive » (op., cit. 1841, II, p. 215). Quoi qu'il en soit, c'est la curiosité – sexuelle, économique, technique, culturelle – et, en l'espèce, cet intérêt pour la différence qui nourrit la discipline, (c'est elle, aussi, vraisemblablement, qui a empêché la spéciation des races)…
Autre contre-exemple – littéraire et réunionnais – de cet engagement, névralgique et éclairé, requis par la discipline : Marius et Ary Leblond se veulent, eux aussi, « peintre des races » (Peintres de Races, études sur l'Art Européen, van Oest, 1909 – « race » équivaut à « nation » sous la plume des Leblond) c'est-à-dire, dans leur propos, militants du rapprochement, non seulement des nations, mais aussi des cultures. Mais ce partage a une limite, parfaitement exprimée dans leur essai intitulé Le Roman colonial. Bien qu'annonçant du romancier colonial qu'« il s'efface – d'instinct beaucoup plus que par système – devant pays et gens qu'il lui est donné d'approcher [...] En faisant âme rase à la fois d'auteur et d'Européen, en regardant, en écoutant, en interrogeant, par-dessus tout en admirant » et que « le but du roman » est de « faire la connaissance » des hommes [...] nous le concevons comme un trait d'union, un trait d'amour entre les humanités qui s'ignorent mais qui si souvent se pressentent et s'attirent » (Le Roman colonial, 1926), ils se montrent très critiques envers les auteurs « retournés ». Ainsi Victor Segalen qui, notent-ils, se révèle « très sceptique vis-à-vis des traditions européennes », et « pris d'un fanatisme de curiosité qui va jusqu'à la mysticité » « quand il s'agit des théogonies ou théocraties maories ou mongoles ». Les Leblond sont aussi parfaitement incrédules devant le Décivilisé de Charles Renel, colon [fasciné] par les mœurs des « indigènes », qu'il finit par adopter : « Son type [...] est faux, fabriqué de mille détails exacts pris à vingt instituteurs dont aucun n'a jamais poussé une nostalgie (fugace) de la philosophie primitiviste jusqu'à renoncer effectivement à nos us et commodités ». Autrement dit : le roman colonial ne saurait mettre en cause la supériorité des mœurs et de la civilisation européenne.
Une question, indirectement posée par ce jugement, est la limite entre le capacité de partage (probablement bridée par un seuil critique au-delà duquel les capacités émotionnelles, définitivement engrammées, ne sont plus susceptibles d'assimilation) et la capacité de compréhension. Nécessairement (et provisoirement) étranger à sa propre culture (mais fidèle à ses réquisits cognitifs), l'observateur doit, universellement, se faire autre. Les conditions de ce déracinement, idéalement constitutives d'une observation impartiale, selon le credo d'Arrien : « …il me suffit de dire que mes ouvrages sont et ont été, depuis mon enfance, ma patrie, ma famille et mes magistratures » (Anabase d'Alexandre, I, 12) peuvent être politiques. C'est Thucydide, témoin et analyste de la guerre du Péloponnèse : « Je l'ai vécue d'un bout à l'autre, étant d'un âge à me rendre bien compte et m'occupant attentivement d'obtenir des renseignements exacts. Il m'est, en plus, arrivé de me trouver exilé vingt ans, après mon commandement d'Amphipolis, et d'assister aux affaires des deux côtés – surtout du côté péloponnésien, grâce à mon exil – ce qui m'a donné la tranquillité pour me rendre, d'une certaine façon, mieux compte des choses » (V, 26, 5). Ou simplement psychologiques. A la manière, parfois, des raisons troubles du Roman colonial, mais inversement, l'obédient naturel d'une culture – de la culture matériellement dominante, pour ce qui concerne cette histoire – d'une religion, d'un genre de vie… s'entête d'autres valeurs et d'un autre mode d'être.
Qui ne fait de sa propre coutume « la reine du monde » ? « Que l'on propose à tous les hommes de choisir, expose une page célèbre d'Hérodote, entre les coutumes qui existent, celles qui sont les plus belles et chacun désignera celles de son pays – tant chacun juge ses propres coutumes supérieures à toutes les autres. Il n'est donc pas normal, pour tout autre qu'un fou du moins, de tourner en dérision les choses de ce genre. Tous les hommes sont ainsi convaincus de l'excellence de leurs coutumes, en voici une preuve entre bien d'autres : au temps où Darius régnait, il fit un jour venir les Grecs qui se trouvaient dans son palais et leur demanda à quel prix ils consentiraient à manger leur père : ils répondirent tous qu'ils ne le feraient jamais, à aucun prix. Darius fit ensuite venir les Indiens qu'on appelle Calaties, qui, eux, mangent leurs parents ; devant les Grecs (qui suivaient l'entretien grâce à un interprète), il leur demanda à quel prix ils se résoudraient à brûler sur un bûcher le corps de leur père : les Indiens poussèrent les hauts cris et le prièrent instamment de ne pas tenir de propos sacrilèges. Voilà bien la force de la coutume, et Pindare a raison, à mon avis, de la nommer dans ses vers « la reine du monde » (Hérodote III, 38, d'après la trad. Barguet).
L'exil, le doute, l'incroyance, la déshérence sociale, le refus du mimétisme… constituent donc des facteurs critiques qui nourrissent le questionnement, naturel ou spécialisé, de la discipline. Le voyage, aiguillonné par la curiosité, s'il permet un regard distant sur soi est évidemment le dispositif le plus ordinaire du regard anthropologique. Bien que cela ne constitue nullement une certification pour l'exercice de la discipline, on comprend que le passage par le « terrain », de préférence aussi distant que possible de son lieu vie, constitue pour l'ethnologue une étape initiatique et que les spécialistes de cette veine regardent leurs collègues « urbains » (« des mondes modernes », « créolistes » ou « de cabinet », qui font de l'ethnologie « chez eux »…) comme n'ayant pas franchi le pas de ce décentrement éducateur. Cette « épreuve » ne suffit évidemment pas à produire du savoir. C'était la remarque de Jean-Jacques Rousseau : « Les particuliers ont beau aller et venir, il semble que la Philosophie ne voyage point » (Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, tome troisième, première partie, note 10, p. 320, 1817, Paris : Belin). Il y faut, comme le recommandent les manuels d'instructions visés plus haut, à la fois de l'engagement et de la distance. Les représentations de Linné dans son Instructio peregrinatoris (1759) sur les devoirs et la conduite du voyageur sont toujours appropriées : « Le tems de voyager, selon notre auteur [Linné], est depuis vingt-cinq ans jusqu'à trente-cinq. Il faut, ajoute-t-il, être modéré dans ses désirs, sobre, tempérant, laisser par-tout une bonne renommée, ne fronder ni les loix ni la religion des pays où l'on vit » (dans : Pulteney, Richard 1730-1801 Linné, Carl von 1707-1778 Millin de Grandmaison, Louis Aubin 1759-1818, Revue générale des écrits de Linné ; Ouvrage dans lequel on trouve les anecdotes les plus intéressantes de sa vie privée, un abrégé de ses systêmes et de ses ouvrages, un extrait de ses aménités académiques…, Par Richard Pulteney ; Traduit de l'anglois, Par L.A. Millin de Grandmaison ; Avec des notes et des additions du traducteur, Paris : Buisson, tome second, p. 197).
Cette instruction préalable doit protéger tant des dérives de l'« exotisme » que du propos de convertir (c'est l'apôtre du progrès, figure moderne du missionnaire – tel celui qui descend de l'avion avec des tracts prônant le « soulèvement populaire », réceptionné par la police locale, son camarade de Fac, originaire du pays et avec qui il a rédigé le tract en cause étant, bien sûr, un honorable correspondant –, le « coopérant » qui épouse la cause, ou la fille, le notable ou le fils… et autres inéquités liées à la disparité nord-sud et à la différence de moyens que l'étranger – fût-il un vahaza sac-à-dos – peut mettre en œuvre). L'enquêteur, réceptif et perméable, s'étant fait une « morale par provision » dans l'esprit de l'aventure cartésienne, doit se rendre invisible et adopter, autant que faire se peut, les manières de ses hôtes, se fortifier d'empathie alors qu'il est autre (« …car je ne m'écartois jamais de ce principe, rapporte Adanson, que rien n'est plus capable de gagner la confiance et l'amitié des étrangers chez lesquels on se trouve, que de se conformer à leur maniere de vivre et à leurs usages ; et je m'en suis toujours bien trouvé » (Histoire Naturelle du Sénégal : Coquillages : Avec la Relation abrégée d'un Voyage fait en ce pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 & 53, chez Claude-Jean-Baptiste Bauche, 1757, p. 31-32). S'il n'a pas conceptualisé cette étrangeté fraternelle, mélange d'identification et de distance, son observation sera biaisée ou lacunaire. Le géographe Julien Thoulet, dans un article paru dans la Revue scientifique en 1893 (LI, p. 808-812) résume le propos : « La meilleure manière – j'allais dire la seule manière de voyager – consiste à voyager jeune, à l'âge où les habitudes n'étant pas invétérées, nous sommes encore susceptibles de les modifier ; et où néanmoins nous sommes doués d'une maturité suffisante pour que nos sentiments et nos facultés soient dans la plénitude de leur développement ». – C'est sur, ce site, Léry, Cauche, Anquetil-Duperron (supra), Tocqueville… « Il faut voyager pauvre, ajoute-t-il, parce que la nécessité de gagner son pain sauve des hésitations si compréhensibles du début et oblige à se jeter dans la mêlée ». Cette discrétion, vert de houx de l'enquête de terrain, permet d'obvier à quelques travers. Anquetil-Duperron proclame : « Le vrai voyageur, c'est-à-dire celui qui aimant tous les hommes comme ses frères, inacessible aux plaisirs et aux besoins […] parcourt le monde sans attache qui le fixe à aucun lieu ». « L'homme qui a su, en élaguant les connaissances, les visites, se créer une solitude au sein du monde, peut au bout de quelques années, avoir le coup d'œil du Voyageur » (Dignité du commerce et de l'état de commerçant, Paris 1789, préface, p. v-vj). Pratiquer l'anthropologie, c'est donc « herboriser » et goûter la proximité humaine ; c'est aussi, grâce, notamment, à l'immense bibliothèque constituée par les voyageurs, prendre de la distance, « systématiser ». Embrasser cette singulière « solitude au sein du monde » pour remonter aux principes.
Le destin de ce transfert d'intérêt qui isole le chercheur et motive la découverte fait universellement question, a fortiori quand le propos est de s'excepter des évidences culturelles de son milieu. La figure « héroïque » et solitaire du pionnier se vérifie dans la biographie d'au moins deux auteurs ici évoqués : Adanson et Anquetil-Duperron.
Adanson : son projet était d'abord de traiter en huit volumes de l'histoire du Sénégal, mais, note Cuvier, « jugeant que l'utilité de sa méthode serait mieux sentie dans une application plus générale », il abandonne ce projet pour se consacrer aux familles de plantes (Familles des plantes, 1763-1764). « Dans sa préface, M. Adanson fait l'histoire de la botanique avec une érudition étonnante dans un homme presque toujours occupé d'observer […] mais c'est seulement de [l']accord plus ou moins parfait [de ceux qui l'ont précédé] avec ses familles naturelles, qu'il en prend la mesure. C'était se mettre lui-même à la tête de tous les botanistes, et en effet il n'était pas trop éloigné de cette opinion » (loc. cit., p. 174-175). Cuvier oppose l'urbanité de Linné à la rugosité d'Adanson et voit dans le succès du premier les raisons, scientifiquement contingentes mais psychologiquement décisives, qui expliquent l'adoption du « système sexuel » de Linné. Adanson, lui, « conservant ses habitudes du désert, inaccessible dans son cabinet, sans élèves, presque sans amis, ne communiquant avec le monde que par ses livres, semblait encore les hérisser exprès de difficultés rebutantes, comme s'il avait craint qu'ils ne se répandissent trop » et qui « avait imaginé jusqu'à une orthographe particulière [de type phonétique], qui faisait ressembler son français à quelque jargon inconnu » (p. 290) ne reçoit pas l'accueil qu'il attendait. « Mais loin de se rebuter de ce peu de succès, à peine s'en aperçut-il. Alors, comme dans tout le reste de sa vie, son propre jugement suffit pour le satisfaire » (p. 176).
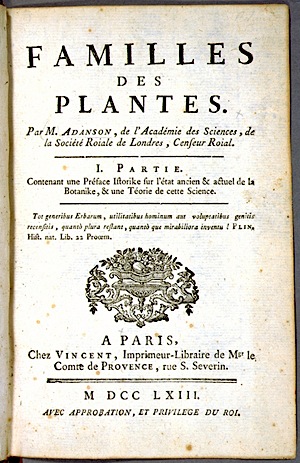
Familles des plantes […]
Contenans une Préface Istorike sur l'état ancien & actuel de la Botanike…
Après avoir publié le premier tome de son Histoire Naturelle du Sénégal et les Familles des plantes, il présente devant l'Académie des sciences, en 1775, le plan d'une encyclopédie dont il serait le seul auteur. « Il ne s'agissait plus, commente Cuvier, d'appliquer sa méthode universelle seulement à une classe, à un règne, ni même à ce qu'on appelle communément les trois règnes, mais d'embrasser la nature entière, dans l'acception la plus étendue du mot. » L'ouvrage devait comporter plus de soixante volumes, 40 000 planches et de nombreuses annexes… Les commissaires requis pour étudier le projet conseillent, dans un rapport daté du 4 mars 1775, de conserver la publication des recherches personnelles d'Adanson et des traités déjà quasi achevés – aux dépens de son « système ». « Adanson n'était pas homme à accepter une semblable leçon […] Il renonce à toute publication. Nommé pensionnaire de l'Académie en 1782, il n'y paraîtra plus guère. Il s'enferme dans sa maison. Plus que jamais, il est l'homme du désert. Il ne voit presque plus personne. En 1784, après quinze ans de mariage, il divorce même, à l'amiable, sous prétexte que la vie commune lui fait perdre trop de temps [Sa fille Aglaë créera l'arboretum de Balaine dans l'Allier]. Ce séquestré volontaire est bientôt presque oublié de la plupart de ceux qui l'entourent. Jour et nuit, il travaille sans relâche à son Encyclopédie, vivant accroupi à la façon des nègres du Sénégal, au milieu d'un monceau de papiers, qu'il couvre de sa fine écriture […] il veut ignorer et il dédaigne tout ce qu'ont fait ou font ses prédécesseurs et ses contemporains » (Lacroix, p. 202). Il meurt le 3 août 1806, « dans un état de misère physiologique » (id., p. 203). Son seul souhait, rapporte Cuvier : « Il a demandé par son testament qu'une guirlande de fleurs prises dans les cinquante-huit familles qu'il avait établies fût la seule décoration de son cercueil : passagère mais touchante image du monument plus durable qu'il s'est érigé lui-même » (loc. cit., p. 188).
Anquetil-Duperron sera aussi ce « renonçant », vivant à l'indienne, avec l'équivoque que cette figure peut engendrer. Voici la caricature que Volney brosse du personnage : « Si vous le voyiez à la classe [à l'Institut], assis droit et immobile, tenant son bâton à mains jointes et tenant ses yeux à demi-fermés, vous le prendriez pour un de ces dévôts indiens qui guettent l'apparition de la flamme bleue (atmâ) sur le bout de leur nez… » (Schwab, op. cit., p. 126). « Du pain avec un peu de lait ou du fromage, et de l'eau de puits, voilà ma nourriture journalière ; elle me coûte quatre sous, la douzième partie d'une roupie indienne : je vis sans feu, même en hiver ; j'ignore l'usage des draps, et des lits de plume ; mon linge de corps n'est ni changé ni lessivé ; je subsiste de mes travaux, sans revenus, sans traitement, sans place, assez bien portant pour mon âge et mes travaux passés ; ni femme, ni enfant, ni domestique, je suis privé de tous les biens, exempt aussi de tous les liens de ce monde ; seul, absolument libre et pourtant très ami de tous les hommes et surtout des gens de probité ; dans cet état, faisant une rude guerre à mes sens, si je ne triomphe pas absolument des atttraits et des tentations du monde, je les méprise ; aspirant d'une âme allègre et par des efforts continuels vers l'Être suprême et parfait, peu éloigné du but, j'attends avec tranquillité la dissolution de mon corps » (Schwab, op. cit., p. 129).
L'autre homme est émotionnellement « indéchiffrable » et, avec ces exemples tangentiels (Adanson « conservant ses habitudes du désert » et vivant « accroupi à la façon des nègres du Sénégal, au milieu d'un monceau de papiers » ; Anquetil en sanyasi…), ce sont sans doute les écrivains-voyageurs (si leur propos n'est pas d'abord de se regarder voyager) qui sont le mieux en mesure de représenter sa fascination – préalable à sa compréhension. Tel, Joseph Conrad, qui écrit, de retour d'un séjour au Congo en 1890 (la conférence de Berlin est de 1885) Heart of Darkness, publié en 1899, roman où la dérision de l'aventure coloniale (« la joyeuse ronde de la mort et du commerce se poursuit dans une atmosphère torride et terreuse comme celle d'une catacombe surchauffée » (p. 73) rencontre le mystère de l'autre (cité dans : Heart of Darkness, Le Cœur des ténèbres, Librairie Générale Française - Le Livre De Poche, 1988). Le meccano des « immenses projets » (p. 293) de l'aventure africaine (« Toute l'Europe [ayant] contribué à l'élaboration de M. Kurtz », le « génie universel » p. 211) révèle la rationalité conquérante (c'est l'époque où l'on fixe les 2 500 000 rivets de la tour Eiffel, de 1887 à 1889) confrontée à logistique tropicale.
« Que voulais-je de plus ? Ce que je voulais en réalité, par Dieu, c'étaient des rivets ! Des rivets. Pour avancer le travail, pour colmater le trou. Je voulais des rivets. Il y en avait des caisses pleines sur la côte, des caisses empilées, éclatées, fendues ! […] Il suffisait de se baisser pour s'en remplir les poches ! Mais il n'y avait pas un seul rivet là où le besoin s'en faisait sentir. […] Et plusieurs fois par semaine une caravane arrivait de la côte avec des marchandises négociables : des calicots satinés tellement laids qu'on frémissait rien qu'à les regarder, de la verroterie qui valait bien deux sous le kilo, d'horribles mouchoirs de coton à pois. Mais pas de rivets » (p. 121).
Même souci avec la caisse de boulons du commandant Lenfant sur La grande route du Tchad : « Lorsqu'il fallut quitter Binndéré-Foulbé [Binder], M. Delevoye s'aperçut que notre caisse de boulons manquait à l'appel. C'était un petit colis très lourd, peu volumineux, mais très important. Sans lui nous ne pouvions remonter le bateau. Comment le retrouver dans les herbes ! Nos perquisitions furent infructueuses. J'en fis part à Bokary qui mit tout son peuple à la recherche ; la population de Binndéré presque tout entière, c'est-à-dire plusieurs milliers d'hommes, fouillèrent les taillis, et ce nous fut un soulagement inexprimable lorsqu'on nous rapporta le précieux colis », Paris : Hachette et Cie, 1905, p. 129-130 ; pour le contexte voir : introduction du chapitre 2).
En contrepoint du constat de Rousseau (« Depuis trois ou quatre cents ans que les habitants de l'Europe inondent les autres parties du monde de nouveaux recueils de voyages et de relations, je suis persuadé que nous ne connaissons d'hommes que les seuls Européens » (Discours, op. cit., note 10, p. 319), des hommes, divers en effet, appelés à « se créer une solitude au sein du monde », s'efforcent d'entrer dans la compréhension d'autres hommes :
« Le vapeur passait lentement tout près d'une frénésie noire et incompréhensible. L'homme préhistorique nous maudissait, ou encore nous offrait une prière ou la bienvenue, qui sait ? Nous étions coupés de tout, incapables des comprendre ce qui nous entourait. Nous glissions sur l'eau tels des fantômes, étonnés et secrètement terrifiés comme le seraient des hommes sains d'esprit confrontés à une explosion d'enthousiasme chez des fous. Nous ne pouvions pas comprendre parce que nous étions trop loin pour nous souvenir, parce que nous voyagions dans la nuit des premiers âges, de ces âges qui ont disparu en ne laissant presque pas de traces et aucun souvenir. La terre n'était plus la terre. Elle nous offre habituellement le spectacle d'un monstre entravé et vaincu, mais là-bas elle restait monstrueuse et libre. Ce n'était plus la terre et les hommes… Non, ils n'étaient pas inhumains. Eh bien, c'était ça le pire, finalement ; qu'ils ne soient pas, en fait, inhumains. […] Que disait ce bruit après tout ? La joie, la peur, le chagrin ; la dévotion, la valeur, la rage, qui peut savoir ? Il disait en tout cas la vérité, la vérité libérée des oripeaux du temps » (Conrad, op. cit., p. 157). « Pourquoi ne suis-je pas descendu à terre me joindre aux hurlements et à la danse ? C'est vrai, je ne l'ai pas fait » (p. 207).
La réflexion sur le monde et sur soi commence avec l'humanité et l'on pourrait dire que le programme de l'anthropologie, comprendre l'homme, est coextensif à la conscience. Un seuil est franchi quand l'homme devient étranger à lui-même et que cette étrangeté devient un objet scientifique. L'exercice anthropologique est ainsi aujourd'hui parallèle à celui de l'observation froide du monde et du développement de la science, quand l'observateur s'astreint à comprendre la condition humaine sans en référer au mythe, à la religion, à toute autre forme de surévaluation de soi. Le modèle méthodologique reste celui des sciences naturelles, alliant la précision descriptive à l'observation longitudinale et plaçant les travaux monographiques dans une perspective globale. À la croisée des disciplines, l'anthropologie est ainsi la science – l'impossible science – de toutes les sciences qui ont l'homme pour objet. Elle doit faire le chemin inverse emprunté par la famille humaine au cours de sa dispersion sur la planète. Cette dispersion a entraîné des adaptations physiques, écologiques et culturelles qui expriment une même capacité de l'homme à s'adapter et c'est à la fois cette unité des outils mentaux qui se déploient dans la diversité des cultures (c'est le dispositif neuronal qui permet à l'homme d'apprendre et de transmettre selon les voies spécifiques d'un langage à double articulation) et cette diversité même qui constituent son propos dans ses deux postulations complémentaires.
La revendication du modèle des sciences constitue évidemment (pour le regard d'aujourd'hui) un moment fondateur de la discipline, mais il y a loin de cette affirmation à sa mise en pratique – pour autant que celle-ci soit possible. La position d'auteurs anciens comme Hérodote, Polybe ou Ibn Khaldoun est probablement plus proche de cet idéal que celle des savants européens du XIXe et du XXe siècle développant la suprématie de l'Europe sur les autres cultures. Née dans le sillage de l'expansion européenne, l'anthropologie est-elle donc « la science des peuples privés de leurs droits » selon le jugement du linguistique soviétique Nicolaï Marr ? Ce serait identifier l'idée de la science et l'histoire contingente de son développement et poser, avec Edmund Husserl – par exemple – que « l'humanité européenne porte en soi une idée absolue au lieu d'être un simple type anthropologique empirique comme 'la Chine' ou 'l'Inde' » (ein bloss empirischer anthropologischer Typus ist wie "China" oder "Indien") (et considérer que « le spectacle de l'européisation de toutes les humanités étrangères annonce en soi l'émergence d'un sens absolu du Monde [proprement européen] et non d'un historique non-sens de ce même Monde », einem historischen Unsinn derselben) (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzentale Phänomenologie, Meiner Verlag, 1996, p. 16). Même s’il faut entendre par cette affirmation que ce n’est pas l’Europe « empirique » qui se distingue ainsi des autres formations culturelles, mais la vocation, née en Grèce, d’avoir à répondre d’un idéal rationnel qui se caractérise par la capacité à objectiver le monde et, partant, à se considérer comme un autre, à s’extraire de sa gangue d’empirie et à porter sur soi et sur les « autres » un « regard désintéressé », il reste que, pour l’européen, révélée par l’anthropologie, « la sarabande des cultures innombrables et équivalentes, chacune se justifiant de son propre contexte, crée un monde […] désorienté » selon la formule d’Emmanuel Lévinas (E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Saint-Clément-de-Rivière : Fata Morgana, 1972, p. 55).
La bruyante cohorte des humanités particulières, cette « sarabande » qui désoriente le philosophe est le lot et le souci de l’anthropologie ordinaire. (La philosophie n’a d’ailleurs pas besoin de cette cacophonie pour connaître ses limites ou pour sortir de soi : la critique de l’eurocentrisme est aussi le fait des européens et « La ‘Pensée sauvage’, c’est une pensée qu’un Européen a su découvrir, ce ne sont pas les penseurs sauvages qui ont découvert notre pensée », observe encore Lévinas (dans : F. Poirié, Emmanuel Lévinas, qui êtes-vous ? Lyon : La manufacture, 1987, p. 114.) Avec le constat qu’il existe d’autres « pensées », ce qui s’impose, en réalité, c’est certes l’évidence, immédiate et triviale, de la relativité des valeurs, mais c’est aussi l’injonction d’avoir à comprendre d’où procède cette différence des cultures historiques. Si, selon le mot de Husserl, Thalès est bien le père originaire (Urvater) de l’Europe, c’est dans la mesure où la science, qui se constitue en se détachant de la perception immédiate, cette capacité à « prendre une attitude critique universelle », porte aussi l’idéal de relativiser les conditions de sa production, comprenant comme empirique et contingente l’humanité historique qui la voit naître. Et si la science moderne, comme telle, selon la critique de Husserl, détachée du savoir global, flotte comme un artisanat indifférent au sens générique de l'humanité (si « le positivisme décapite, pour ainsi dire, la philosophie » - p. 8), alors l'anthropologie, partagée et nourrie par les types « empiriques » d'humanité visés, faisant appel à toutes les civilisations où le savoir scientifique s’est développé, peut avoir vocation à devenir, dans un monde en recomposition, la théorie des humanités, puis de l'humanité générique…
Par l'étude des différentes cultures, l'anthropologie recherche, en effet, les universaux de l'espèce, l'unité de l'humanité sous la diversité de ses expressions. L'homme moderne est en mesure de faire le relevé et le bilan – et l'expérience – des outils culturels, matériels, chimiques, physiologiques mis en œuvre pour vivre en société. Alors que l'espèce a commencé à quitter le berceau de la planète avec la « conquête spatiale » (premier homme sur la lune en 1967) et qu'elle a pouvoir, depuis l'identification de l'ADN (1957), de domestiquer son propre génome, l'anthropologie propose les moyens d'une réflexion sur les communs du passé et de l'avenir. La compréhension des logiques particulières (contraintes écologiques, choix culturels) et la recherche des invariants sous la diversité des adaptations engagent deux démarches complémentaires qui requièrent les outils des deux cultures et qui réconcilient les savoirs : ceux des « humanités » et ceux qui sont mis en œuvre pour une approche positive de l'humanité : les différentes sciences objectives.
Un modèle d'ethnographie :
Michel de Montaigne, Journal de voyage ..., avec des notes par M. de Querlon, 1774.
Montaigne assiste à une circoncision.
Le trentième [de janvier 1581], il fut voir la plus ancienne cérémonie de religion qui soit parmi les hommes, et la considéra fort attentivement et avec grande commodité : c'est la circoncision des Juifs. Elle se fait aux maisons privées, en la chambre du logis de l'enfant la plus commode et la plus claire. Là où il fut, parce que le logis était incommode, la cérémonie se fit à l'entrée de la porte. Ils donnent aux enfants un parrain et une marraine, comme nous : le père nomme l'enfant. Ils les circoncisent le huitième jour de sa naissance. Le parrain s'assit sur une table, et met un oreiller sur son giron : la marraine lui porte là l'enfant, et puis s'en va. L'enfant est enveloppé à notre mode ; le parrain le développe par le bas, et lors les assistants, et celui qui doit faire l'opération, commencent trestous (a) à chanter, et accompagner de chansons toute cette action qui dure un petit quart d'heure. Le ministre peut être autre que rabbi (b), et quiconque ce soit d'entre eux, chacun désire être appelé à cet office, parce qu'ils tiennent que c'est une grande bénédiction d'y être souvent employé : voire ils achètent d'y être conviés, offrent, qui un vêtement, qui quelque autre commodité à l'enfant, et tiennent que celui qui en a circoncis jusqu'à certain nombre qu'ils savent, étant mort, a ce privilège que les parties de la bouche ne sont jamais mangées des vers. Sur la table, où est assis ce parrain, il y a quant-et-quant (c) un grand apprêt de tous les outils qu'il faut à cette opération. Outre cela, un homme tient en ses mains une fiole pleine de vin et un verre. Il y a aussi un brasier à terre, auquel brasier ce ministre chauffe premièrement ses mains, et puis, trouvant cet enfant tout détroussé (d), comme le parrain le tient sur son giron la tête envers soi, il lui prend son membre, et retire à soi la peau qui est au-dessus, d'une main, poussant de l'autre la gland (e) et le membre au-dedans. Au bout de cette peau qu'il tient vers ladite gland, il met un instrument d'argent qui arrête là cette peau, et empêche que le tranchant ne vienne à offenser la gland et la chair. Après cela d'un couteau, il tranche cette peau, laquelle on enterre soudain dans de la terre, qui est là dans un bassin parmi les autres apprêts de ce mystère. Après cela le ministre vient, à belles ongles, à froisser encore quelque autre petite pellicule qui est sur cette gland et la déchire à force, et la pousse en arrière au-delà de la gland. Il semble qu'il y ait beaucoup d'effort en cela et de douleur : toutefois ils n'y trouvent nul danger, et en est toujours la plaie guérie en quatre ou cinq jours. Le cri de l'enfant est pareil aux nôtres qu'on baptise. Soudain (f) que cette gland est ainsi découverte, on offre hâtivement du vin au ministre qui en met un peu à la bouche, et s'en va ainsi sucer la gland de cet enfant, toute sanglante, et rend le sang qu'il en a retiré, et incontinent reprend autant de vin jusqu'à trois fois. Cela fait on lui offre, dans un petit cornet de papier, d'une poudre rouge qu'ils disent être du sang de dragon (g), de quoi il sale et couvre toute cette plaie, et puis enveloppe bien proprement le membre de cet enfant à tout (h) des linges taillés tout exprès. Cela fait, on lui donne un verre plein de vin, lequel vin, par quelques oraisons qu'il fait, ils disent qu'il bénit. Il en prend une gorgée, et puis. y trempant le doigt, en porte par trois fois à tout (h) le doigt quelque goutte à sucer en la bouche de l'enfant : et ce verre après, en ce même état, on l'envoie à la mère et femmes qui sont en quelque autre endroit du logis, pour boire ce qui reste de vin. Outre cela, un tiers prend un instrument d'argent, rond comme un œuf (i), qui se tient à une longue queue, lequel instrument est percé de petits trous comme nos cassolettes, et le porte au nez premièrement du ministre, et puis de l'enfant, et puis du parrain : ils présupposent que ce sont des odeurs, pour fortifier et éclaircir les esprits à la dévotion.
(a) Tous sans exception. (b) rabbin. (c) Aussi. (d) Déshabillé. (e) Nous disons : le, mais Montaigne conserve ordinairement en français le genre des mots latin, comme celui de glans, qui est féminin. (f) Aussitôt. (g) Substance résineuse qui découle d'un arbre et dont il y a quatre espèces. (h) Avec. (i) Une balle. (Les notes sont de l'éditeur du manuscrit.)
Observateur scrupuleux, Montaigne pose aussi l'équivalence des valeurs :
« Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté : sinon que chacun appelle barbarie, ce qui n’est pas de son usage. Comme de vray nous n’avons autre mire de la verité, et de la raison, que l’exemple et idée des opinions et usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la parfaicte religion, la parfaicte police, parfaict et accomply usage de toutes choses. Ils sont sauvages de mesmes, que nous appellons sauvages les fruicts, que nature de soy et de son progrez ordinaire a produicts : là où à la verité ce sont ceux que nous avons alterez par nostre artifice, et destournez de l’ordre commun, que nous devrions appeller plustost sauvages » (Essais, livre I, XXX).
|
|